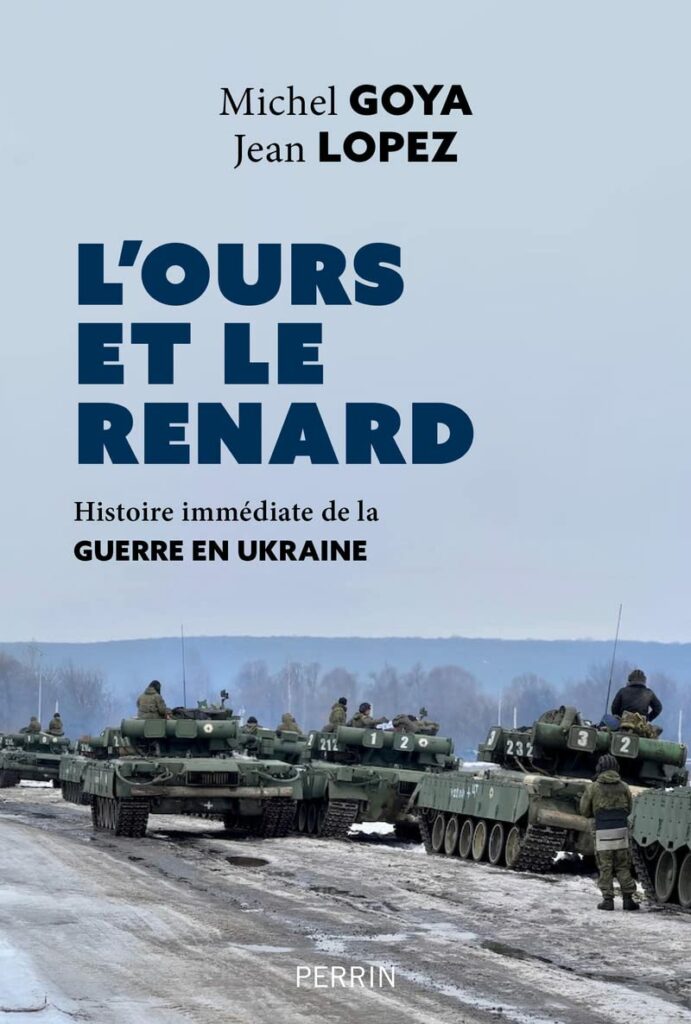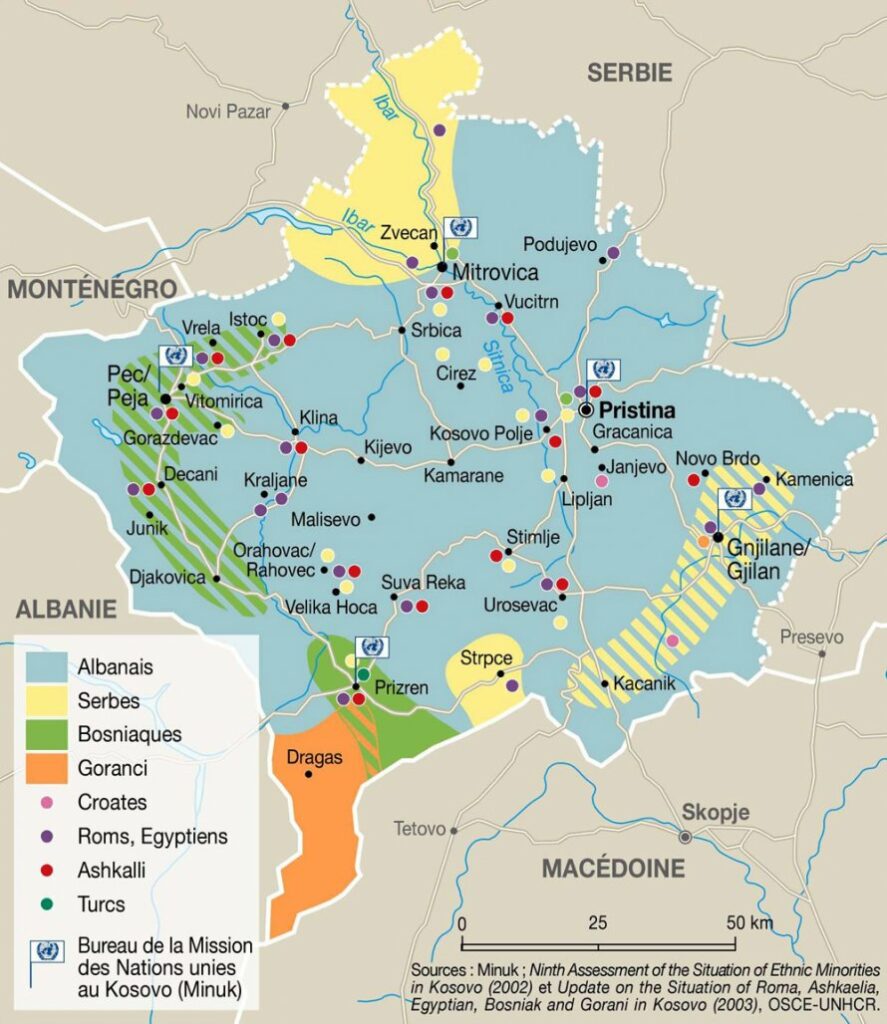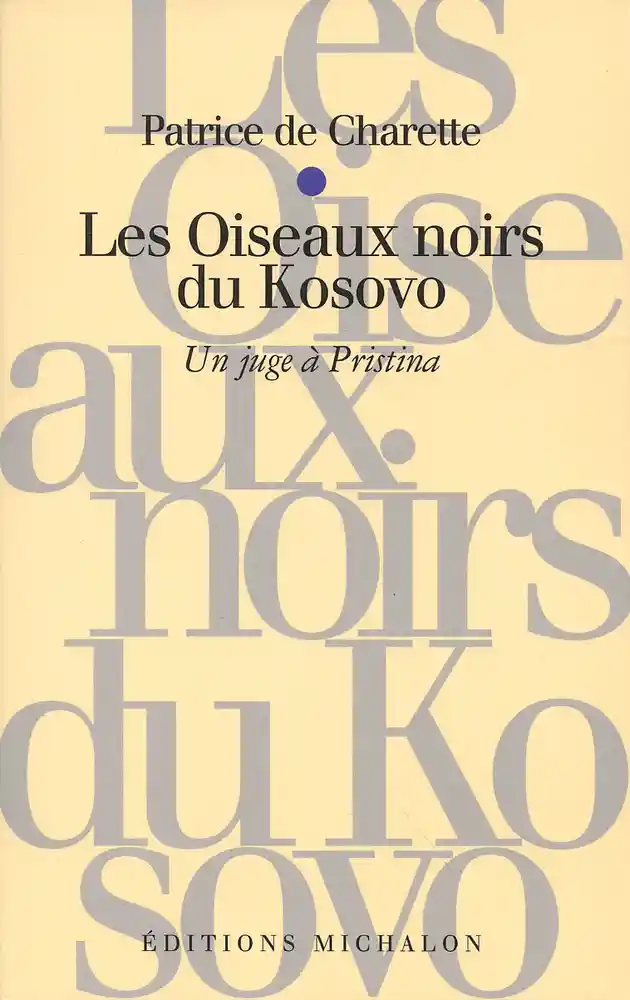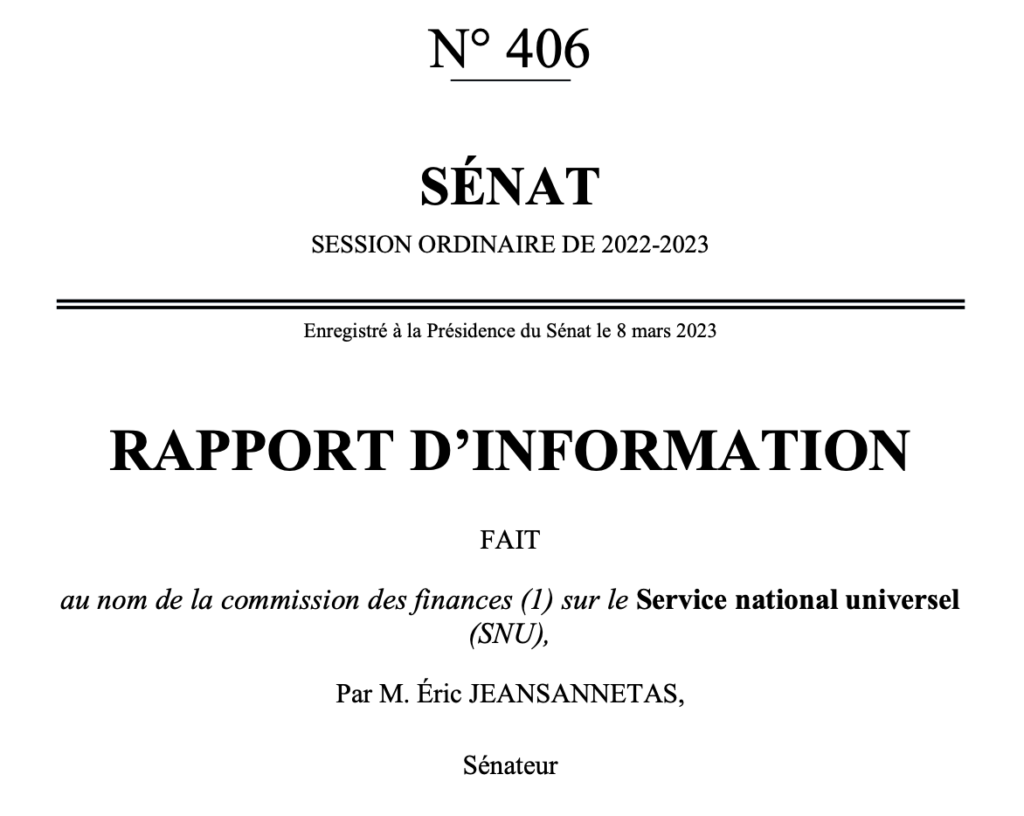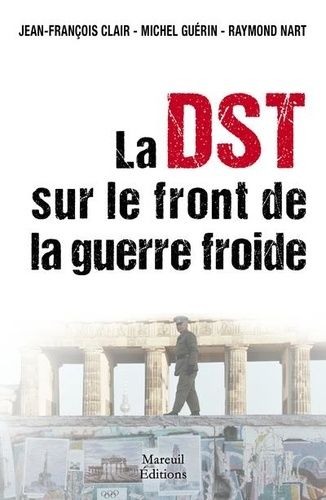Article écrit le 19 août 2023 par Nghia NGUYEN
– 180e promotion Cardinal de Richelieu
– Professeur agrégé au Lycée Jean Monnet (Cognac)
Dans un article particulièrement critique à l’encontre du Puy du Fou, l’universitaire Guillaume MAZEAU affirmait l’essentiel des arguments utilisés par les détracteurs du parc vendéen à savoir que celui-ci est une entreprise idéologique manipulant et falsifiant l’Histoire à des fins identitaires (1). Partant, l’œuvre du Puy du Fou resterait représentative d’une réaction anti modernité caractéristique des milieux conservateurs et traditionnalistes chrétiens. La conclusion qu’en tire M. MAZEAU, qu’il développe dans un ouvrage publié de manière concomitante, est que l’Histoire doit s’émanciper de tous les discours promouvant la Nation et l’identité nationale (2).
L’universitaire, dont l’article est au demeurant parcouru d’erreurs voire de contre-vérités (3), s’inscrit dans la réflexion de l’historienne Suzanne CITRON (1922-2018) (4) qui avait notamment pour ambition de refonder l’enseignement de l’Histoire de l’École primaire au Lycée en l’expurgeant de tous liens avec l’idée nationale. Cette orientation tout aussi idéologique que le nationalisme lui-même a abouti à la fondation d’une association en 2005 : le Comité de Vigilance face aux Usages publics de l’Histoire (CVUH). En dépit de son titre pouvant inspirer au premier abord la neutralité de la science historique dont il serait le gardien, ce comité réunit surtout des historiens de gauche et d’extrême gauche dont la « vigilance » cible avant tout, et bien évidemment, les adversaires politiques. Véritable vice ayant masque de vertu, ledit comité a, en fait, pour objectif de faire croire que tout ce qui se rattache de près ou de loin à l’histoire nationale est dans le meilleur des cas controversé et suspect voire, dans le pire des cas, condamnable.
L’article de M. MAZEAU est ainsi représentatif de ce « combat culturel » qu’il prête au Puy du Fou mais qu’il mène en réalité avec d’autres historiens, pour imposer une vision de « la bonne histoire » : celle qui serait par nature objective et neutre à laquelle viendrait en repoussoir une histoire orientée et à rejeter.
Qu’en est-il réellement ?
Qu’est-ce que le roman national ?
Ce que les historiens du CVUH contestent dans l’oeuvre du Puy du Fou est une vision identitaire de l’histoire véhiculée par le « roman national », un genre qu’ils attaquent vivement. Il l’est d’autant plus que la dégradation de l’enseignement de l’histoire dans les écoles, collèges et lycées s’accompagne, de nos jours, d’un véritable intérêt populaire pour le passé comme en témoignent le succès des émissions de Stéphane BERN, Franck FERRAND et de manifestations telles les Journées du Patrimoine (5). L’écho réel que rencontre le Puy du Fou au sein de la population – et au-delà même de la France – ne fait que confirmer cet intérêt ; véritable demande culturelle à laquelle répond une vulgarisation historique et un roman national au grand dam de M. MAZEAU et du CVUH.
Qu’est-ce donc que ce roman national qui cristallise tant de la part de ses détracteurs et opposants mais continue d’émerveiller un plus grand nombre par ailleurs ? Le roman national est une forme de narration historique qui a pu désigner des choses très différentes selon les époques (6). L’historien David GAUSSEN a ainsi montré que bien avant la Révolution française, la Monarchie capétienne avait déjà son propre roman dans lequel étaient exaltées ses origines et sa légitimité. C’est cependant au XIXe siècle, à la confluence des littératures romantiques et nationales, que se structure véritablement le roman national tel que nous l’entendons aujourd’hui. De manière générale, il se présente comme une histoire racontant l’Histoire et dans laquelle les faits s’organisent au sein d’une destinée commune dont le personnage central n’est autre que la Nation. D’un côté le roman national a pu se présenter comme une fiction littéraire n’hésitant pas à faire intervenir des éléments légendaires, miraculeux ou prophétiques ; de l’autre comme une fresque présentant la France telle une entité déjà existante sur le temps long (depuis l’Antiquité) et mettant en perspective des personnalités et des événements fondateurs dont la succession au fil des siècles, les actions et les conséquences, aboutissent à la naissance d’une véritable nation française. Ce genre de fresque a été particulièrement représentée par une école historique à laquelle le nom de Jules MICHELET (1798-1874) est resté attaché.

La geste intéresse davantage le roman national que l’exactitude historique (ici des équipements romains fantaisistes).
Contemporain du mouvement romantique, issu de la bourgeoisie intellectuelle libérale et anticléricale, profondément influencé par les idéaux révolutionnaires de 1789, MICHELET a affirmé une « histoire totale » cherchant à expliquer le parcours de la nation française au fil des siècles (7). Il n’est pas le seul historien du roman national mais par l’ampleur de son oeuvre il en est considéré comme l’un des fondateurs modernes. Pénétré par « le sens des grandes forces collectives », il a surtout cherché à faire revivre dans son intégralité la chair historique, écrivant l’Histoire avec « un goût de l’homogène et de la continuité » comme a pu l’analyser Roland BARTHES (8). Ce faisant, il lègue une vision de l’histoire schématisée, souvent bipolarisée autour de forces contraires (le Christianisme et la Révolution par exemple). L’histoire de MICHELET est celle de « chaînes d’identités » où les destins individuels, ceux des rois ou de personnes (Jeanne d’Arc par exemple), annoncent ce que sera plus tard le Peuple français et la France. Cela amène l’historien a idéalisé une période comme le Moyen-Âge, matrice de l’époque moderne, et à projeter celui-ci dans une France vécue comme une personne. Cette France transcende dès lors ceux qui la constituent pour incarner l’idée d’une unité harmonieuse supérieure.
Historien d’une France républicaine à la recherche de son propre récit, MICHELET ne prétend pas à l’objectivité. Bien au contraire, il projette ses passions et ses émotions dans son écriture, non sans érudition mais à partir d’un puissant inconscient idéologique. L’histoire de MICHELET est une histoire vivante qui a marqué des générations d’historiens et qui a, incontestablement, ancré un roman national dans la psyché française. Étudiant cependant le passé avec une vision déformée par les lunettes du présent – et le biais de l’idéologie républicaine – MICHELET a depuis été remis en cause par les évolutions de l’épistémologie et de l’historiographie (9).
Si aujourd’hui le roman national ne peut plus être confondu avec l’écriture de l’Histoire au sens moderne est-il pour autant condamnable dans son intégralité ? Partant d’une trame factuelle qu’il romance et idéalise, il n’en demeure pas moins attaché à un fil historique permettant aux non historiens – c’est-à-dire l’immense majorité de la population pour ne pas dire la société – de renouer justement avec l’Histoire. Une histoire, il est vrai, inexacte mais qui est la première passerelle vers la vulgarisation puis, au-delà, la spécialisation. Si le roman national n’est plus l’Histoire proprement dite, par son caractère vivant il n’en demeure pas moins un créateur d’intérêt pour celle-ci, si ce n’est l’indispensable point d’entrée.
C’est ce pari que tente – visiblement avec succès – le Puy du Fou nonobstant l’opposition de ses détracteurs qui refusent de voir dans leurs contemporains cette demande d’ancrage dans le passé. Une demande qui s’opère, qu’on le veuille ou non, à partir d’une identification de la chair de la société actuelle avec celle du passé. Si l’Histoire, par la complexité de ses acteurs et de ses aléas, ne se laisse pas enfermer dans le roman national, ni dans une intention politique identitaire étroite, peut-on dire pour autant que l’identité des hommes, des groupes, des peuples, des civilisations n’existe pas ? L’Histoire dit justement le contraire que ce soit aux sources du réel comme de ses représentations les plus fantasmées.
Surtout, le procès en roman national et inexactitudes historiques intenté au Puy du Fou par certains universitaires n’a pas lieu d’être pour la bonne et simple raison que le Puy du Fou n’a jamais été une université, un IEP, ni une grande école, et encore moins avoir prétendu de près ou de loin vouloir se substituer à un quelconque organisme d’enseignement de l’histoire. Cela est d’autant plus ridicule que le principe même de cette critique devrait aussi, en toute logique, conduire ces universitaires à s’en prendre avec la même conviction au parc Astérix et à la vision qu’il véhicule des civilisations celte et romaine. Voire à la vision des Amérindiens ou autres peuples telle qu’elle apparaît dans l’univers de Disneyland Paris.

Le roman national fait intervenir le divin dans la narration historique.
Derrière certains historiens se cachent des militants politiques
La question du roman national ne dit, au fond, qu’une chose : l’Histoire reste un objet profondément et passionnément politique. Pourtant, l’historien se doit d’être nuancé et conscient de la complexité des événements au point d’y gagner une authentique probité et reconnaissance intellectuelles. C’est toute la difficulté d’un métier dont l’écriture sera toujours inachevée et en tension du fait des nécessaires interprétations à donner à son objet même. Le bon historien n’a cependant pas pour mission de fournir des argumentaires idéologiques et médiatiques ; encore moins à se présenter comme un militant politique ce qui en soi et d’emblée le disqualifie ès qualités. Il devrait même, en toute honnêteté, pouvoir écrire des choses allant à l’encontre de ses convictions. On comprendra dès lors qu’au procès instruit au Puy du Fou en récit historique désuet et rétrograde, les contempteurs du roman national lorsqu’ils s’appellent Guillaume MAZEAU, Mathilde LARRÈRE et Laurence DE COCK ne sont guère à prendre au sérieux.
Quintessence du dévoiement idéologique de l’Histoire (et des sciences humaines de manière générale), ces historiens anti Puy du Fou relèvent non seulement d’un mélange des genres – une université instruit, un parc d’attraction divertit – mais également d’une démarche idéologique et politique plus soucieuse de faire entrer l’objet historique dans des cases de pensée que de l’éclairer. Comme ils le revendiquent, non sans orgueil, ils sont à « la recherche de vérité » (10) là où l’Histoire ne suit que des traces, tentant d’établir la réalité des choses qui se sont produites par le passé. Le reste n’étant qu’interprétations selon les apports d’une recherche toujours en mouvement au prisme de différentes époques.
L’objet de l’Histoire est le Réel et non la Vérité qui nous emmène dans une dimension morale. C’est cette recherche systématique d’un discours moralisateur, d’un jugement permanent étranger à l’histoire et réalisé à coup d’anathèmes médiatiques sur fond de cancel culture qui, paradoxalement, fonde l’immoralité caractéristique de ces militants politiques fussent-ils parés de titres universitaires. L’Histoire s’intéresse à la réalité des hommes fut-elle fallacieuse et faite de mensonges à commencer par le mensonge idéologique qui, en son essence et par définition, ne peut être vrai mais est pourtant bien réel quant aux tragédies humaines qu’il impose. La sincérité de cette « recherche de vérité » interroge par ailleurs de la part de personnes dont l’indignation, la rage et les haines intellectuelles et médiatiques sont si relatives – pour ne pas dire à géométrie variable – que ce soit à l’endroit de lois mémorielles, de personnes identifiées comme étant de droite, et d’autres causes relevant de ce que l’on appelle de nos jours la « bien-pensance » (11).
Ces historiens sont tous connus pour leurs engagements politiques à gauche voire à l’extrême gauche. À commencer par Nicolas OFFENSTADT (12) l’un des fondateurs de la CVUH avec Gérard NOIRIEL et Michèle RIOT-SARCEY. Cette dernière, partie du communisme, est aujourd’hui engagée dans les luttes intersectionnelles (13). À leurs côtés, on trouvera également Laurence DE COCK, membre du Parlement de la NUPES (14), qui fut présidente de la CVUH et préfaça la dernière édition du Mythe national de Suzanne CITRON. Mathilde LARRÈRE, également membre de la CVUH, a accompagné Jean-Luc MÉLENCHON du Parti de gauche au Parlement de la NUPES (15). Quant à Guillaume MAZEAU, il fut le thésard de Jean-Clément MARTIN lui-même descendant de l’école d’Albert MATHIEZ et de Georges LEFEBVRE, autrement dit l’école historique marxiste de la Révolution française.
À la façon d’un MICHELET qu’ils vouent aux gémonies, ces historiens font pourtant, eux aussi, de l’histoire avec des lunettes politiques et à partir de schèmes idéologiques bien identifiés. Tous infirment le mot de François FÉNÉLON (1652-1715), certes discutable, selon lequel « Le bon historien n’est d’aucun temps ni d’aucun pays » (16) mais à la différence du grand historien de la IIIe République qui cherchait à construire à sa manière une unité de la Nation, les militants contemporains du « vivre-ensemble » ajoutent à leur idéologie le cynisme de la déconstruction anthropologique.

Le film hollywoodien s’inspire de l’oeuvre de Walter SCOTT (1771-1832), écrivain romantique écossais et auteur de romans historiques. Dans Ivanhoe, l’Angleterre médiévale est idéalisée avec la transposition de l’idée d’unité nationale (XIXesiècle) sur une époque féodale (XIIe siècle).
L’Histoire ne forme pas des patriotes mais l’École si
Si la notion de roman national apparaît, donc, bien plus ancienne et plus différenciée qu’on ne pourrait l’imaginer, c’est essentiellement avec la IIIe République et la naissance d’une instruction nationale qu’elle naît telle que fustigée de nos jours par les idéologues de gauche. De Suzanne CITRON à Nicolas OFFENSTADT, les militants du CVUH mettent en avant un engagement soit-disant « civique » et « républicain » devant constituer une digue intellectuelle contre l’extrême droite nationaliste et patriote. Tous professent du même credo : l’histoire n’a pas à former des patriotes et M. MAZEAU de s’indigner que « Les données collectées lors d’une enquête récente confirment la dangerosité de ces usages du passé : pour une partie des élèves de collège, l’histoire racontée au Puy du Fou serait plus fiable que celle de l’école, accusée d’être « officielle » et mensongère. » (17) Quand bien même cela serait-il vrai à qui revient la faute de manipulations idéologiques qui n’ont cessé de creuser la défiance vis-à-vis de l’institution scolaire ?
Durant des générations, l’Éducation nationale est restée aux mains de sociologues bourdieusiens et d’idéologues marxistes – aujourd’hui wokes – qui se sont acharnées à dénaturer et à pervertir une instruction qui se devait de rester gratuite (au sens désintéressée), neutre et respectueuse des élèves et des familles. Or combien de professeurs ont-ils confondu à dessein leurs salles de classe avec la cellule d’un parti politique ou d’une section syndicale ? Un Alexis CORBIÈRE (Lettres-Histoire) comme une Nathalie ARTHAUD (Économie-Gestion) en sont les exemples les plus caricaturaux dont on imagine sans peine le genre de « cours » qu’ils ont pu donner à leurs élèves des années durant.
Le ver n’était-il cependant déjà pas dans le fruit quand on sait que l’école républicaine a, elle aussi, été conçue dès l’origine comme une arme contre les opposants de la République ? Les hussards noirs avaient ainsi pour mission de faire accepter le nouveau régime par les Français partant de combattre les deux adversaires identifiés de la République : la Monarchie et le Catholicisme. Voilà pourquoi l’École française reste – très certainement plus qu’ailleurs exception faite des pays autoritaires – une institution éminemment politique et politisée davantage en charge d’une éducation que d’une instruction comme son nom l’indique par ailleurs.
Les hussards de la République avaient cependant pour eux un esprit de vocation, l’idée d’une transcendance, une rigueur intellectuelle que l’on chercherait en vain, de nos jours, dans nombre de salles des professeurs d’écoles, de collèges et de lycées. Ils avaient pour eux une exigence personnelle et pour leurs élèves une estime qui ont fait vivre des générations durant l’idée méritocratique. Leur élitisme était généreux et ouvert contrairement au monde de l’entre-soi d’un Jean-Clément MARTIN ou d’un Guillaume MAZEAU qui voudraient faire de l’histoire une science uniquement réservée à des spécialistes afin de mieux pouvoir en contrôler les orientations idéologiques. La discipline serait ainsi confisquée au profit d’une hypercritique intellectuelle uniquement réservée à une caste académique et militante dont l’objectif serait de relativiser (et de faire oublier) ce qui gêne d’un côté et de magnifier entre hier et aujourd’hui de l’autre. Bref, c’est la volonté d’écrire un autre roman mais en rendant, cette fois, la confrontation des idées et des analyses non souhaitable. À la manière d’un terrorisme intellectuel qui marginaliserait d’entrée de jeu ses contradicteurs, il n’y aurait ainsi qu’une façon d’aborder les faits (18).
Si l’histoire n’a pas pour vocation de former ni des patriotes ni des citoyens, il n’en est pas de même pour une instruction civique dont l’École républicaine s’est donnée pour mission d’en faire le ciment éducatif de la société dès le XIXe siècle. Qu’elle fût par la suite nommée et renommée Éducation civique, Éducation Civique Juridique et Sociale ou Enseignement Moral et Civique, sa réalité demeure fondamentalement la même : faire comprendre qu’il ne peut y avoir de société sans valeurs partagées et que ce partage implique d’abord des devoirs et ensuite des droits. Cela fait malheureusement depuis longtemps que l’école actuelle ne répond plus à sa principale mission qui est de transmettre à la fois connaissances et valeurs partagées. Pire, elle a inversé la hiérarchie du sens commun faisant désormais passer les droits des individus devant les devoirs du citoyen. Cependant, quelle que soit l’appellation de l’enseignement – et si les mots ont encore un sens -, il ne pourrait y avoir d’Éducation civique digne de ce nom sans devoirs dont le premier demeure celui de la défense du pays et de la Nation.
Si l’histoire n’a pas vocation à former des patriotes – à savoir des personnes suffisamment amoureuses de la terre de leurs pères pour vouloir en défendre et féconder l’héritage -, elle n’en demeure pas moins toute entière traversée de luttes, de sacrifices, de causes et de héros. N’en déplaise aux partisans d’une histoire mondiale dont font partie les détracteurs du roman national mais c’est d’un groupe culturellement homogène qu’est née la Cité dont l’appartenance se fondait sur un seul et premier devoir : sa défense. Ce n’est donc pas l’Éducation civique mais l’Histoire qui trace le chemin qui va de la cité-État à l’État nation. Alors si l’histoire en tant que discipline scientifique n’a pas à former des patriotes, elle n’est pas non plus étrangère à l’intérêt profond porté à la terre et à la communauté culturelle qui l’habite, et c’est cela qui fonde in fine le patriotisme. L’histoire occupe ainsi une place aussi naturelle qu’elle est essentielle dans l’enseignement de défense et la géopolitique. Elle demeure profondément liée à l’Esprit de défense si l’on comprend que celui-ci dépasse les seuls intérêts marchands et économiques d’une société à un moment donné. Une communauté humaine sans histoire et sans patriotes ne pourra pas conscientiser un Esprit de défense. Inversement, il ne pourra jamais y avoir de patriotisme sans un rapport amoureux à la terre des pères, et cela passe par l’Histoire qu’elle soit ou non déformée au prisme du roman national.
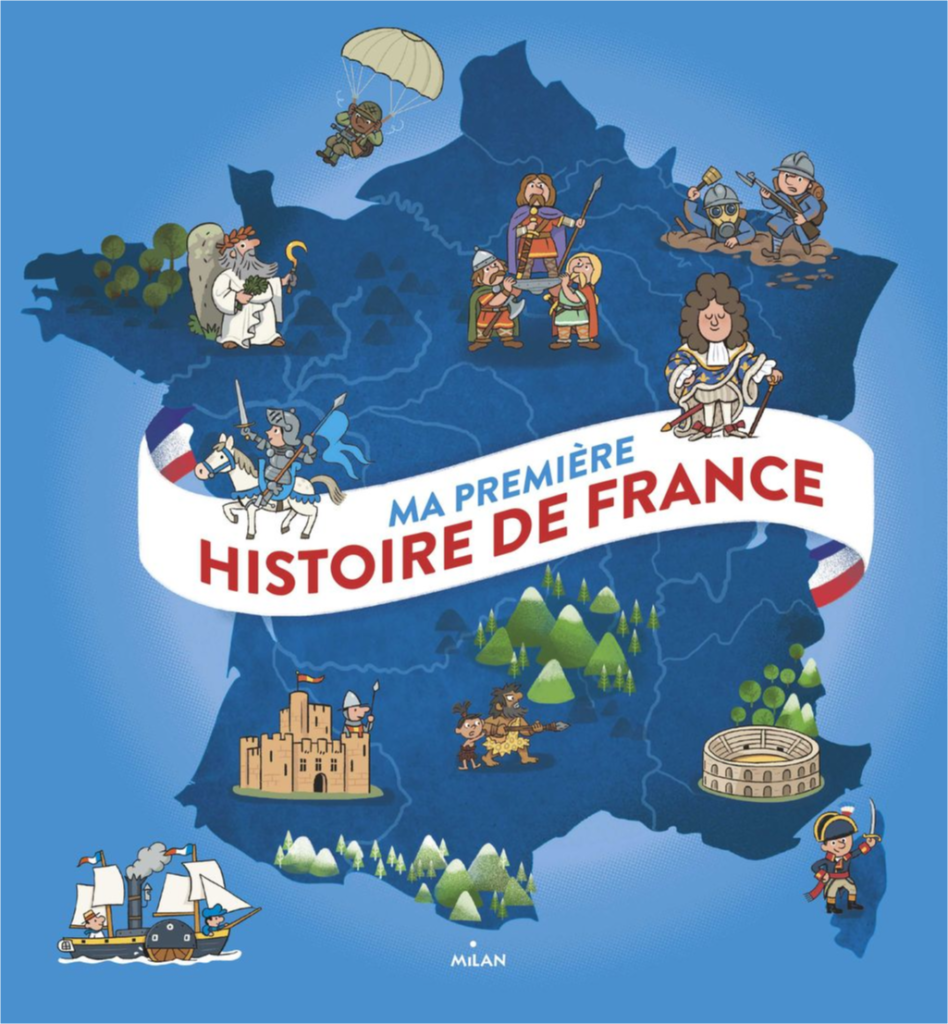
Et le Puy du Fou dans tout ceci ? Il reste plus que jamais conforme à ce qu’il est à savoir un parc d’attraction à succès qui – par le divertissement – donne à aimer l’Histoire de France plus qu’à l’analyser comme le ferait un cours d’histoire : ce qu’il n’est pas. Fictif tout en détenant une part de réel, le roman national est-il donc nécessaire ? En fait, la question qu’il pose ne devrait pas relever de l’utilité si ce n’est à vouloir se poser la question de la place du rêve dans nos existences. Le rêve nous est-il utile ? On pourrait aussi s’interroger autrement à savoir ce que seraient nos vies sans le rêve ? Pour les uns, il permet d’avancer et de déplacer des montagnes ; pour d’autres sa confusion permanente avec le réel peut présenter des dangers. Le roman national sert avant tout à imager l’Histoire à un âge où les individus ne sont pas encore capables de prendre une conférence en notes ni d’accéder aux concepts permettant d’approfondir la science historique.
En d’autres termes, il permet l’éclosion d’un intérêt pour l’Histoire, voire d’une première conscience historique dès l’âge de l’enfance. Libre ensuite à certains de ces enfants devenus adultes, de vouloir creuser le sillon de la science du passé aidés en cela par des Maîtres dont l’érudition, la droiture, la capacité à distinguer un fait d’une opinion ne feront pas défaut.
_______________
- Cf. The Conversation [en ligne]. MAZEAU (Guillaume), « Le Puy du Fou : sous le divertissement, un « combat culturel », 29 mars 2019. Disponible sur https://theconversation.com/le-puy-du-fou-sous-le-divertissement-un-combat-culturel-113888 [consulté 4 août 2023].
- Cf. DE COCK (Laurence), LARRÈRE (Mathilde), MAZEAU (Guillaume), L’Histoire comme émancipation, Agone, 2019, 128 p.
- Cf. Le droit de réponse exercé par le Puy du Fou à la suite de MAZEAU (Guillaume), « Le Puy du Fou : sous le divertissement, un « combat culturel », op. cit.
- Cf. CITRON (Suzanne), Le mythe national. L’Histoire de France revisitée, Éditions de l’Atelier, 2019, 357 p.
- Cf. On y ajoutera aussi des succès de librairie comme DEUTSCH (Lorànt), Métronome. L’histoire de France au rythme du métro parisien, Pocket, 2014, 432 p.
- Cf. Pour approfondir cette question lire GAUSSEN (David), Qui a écrit le roman national ? De Lorànt Deutsch à Patrick Boucheron, l’histoire de France dans tous ses états, Éditions Gaussen, 2020, 253 p.
- Cf. MICHELET (Jules), Histoire de France, Flammarion, 2013, 576 p.
- Cf. BARTHES (Roland), Michelet, Seuil, 1995, 192 p.
- Cf. SAMARAN (Charles) dir. L’Histoire et ses méthodes, Encyclopédie de la Pléiade, Bruges, Gallimard, 1961, 1174 p. BOURDÉ (Guy) et MARTIN (Hervé), Les écoles historiques, Seuil, 1983, 418 p. CAIRE-JABINET (Marie-Paule), Introduction à l’historiographie, Armand Colin, 5e éd. 2020, 224 p.
- Cf. MAZEAU (Guillaume), « Le Puy du Fou : sous le divertissement, un « combat culturel », op. cit.
- Cf. Revue des Deux Mondes, « Les bien-pensants. De Rousseau à la gauche « morale » l’histoire du camp du bien », février-mars 2016, 224 p. Lire également MORICE KERNEVEN (Ayrton), « Franck Ferrand « réac » : quand Libération nous offre un cas d’école de mauvaise foi et d’hypocrisie », in Le Figaro, 18 juillet 2023.
- Cf. OFFENSTADT (Nicolas), L’histoire, un combat au présent, Textuel, 2014, 96 p.
- Cf. VALENTIN (Pierre), « L’idéologie woke. Anatomie du wokisme », FONDAPOL, juillet 2021, 60 p. Théorisée par la juriste américaine Kimberle Williams CRENSHAW, et s’inspirant de la lutte des classes marxiste, l’intersectionnalité est l’autre nom du Wokisme qui n’entrevoit l’Humanité que sous un ensemble de dominations et d’exploitations qu’il faut combattre en faisant converger et se recouper (intersections) toutes les grandes luttes sociales et sociétales contre les inégalités et discrimination qu’elles soient raciales, économiques et sociales, de genres, sexuelles, religieuses. Partant, l’idéologie intersectionnelle/woke préconise la déconstruction de toutes les normes anthropologiques qui fondent les identités ethniques, culturelles, sexuelles, sociales.
![Association régionale Poitou-Charentes des auditeurs de l'IHEDN [AR-18]](https://ihednpoitoucharentes.fr/wp-content/uploads/2024/10/cropped-Bandeau_AR-18_Site_OVH_v4a-1.jpg)