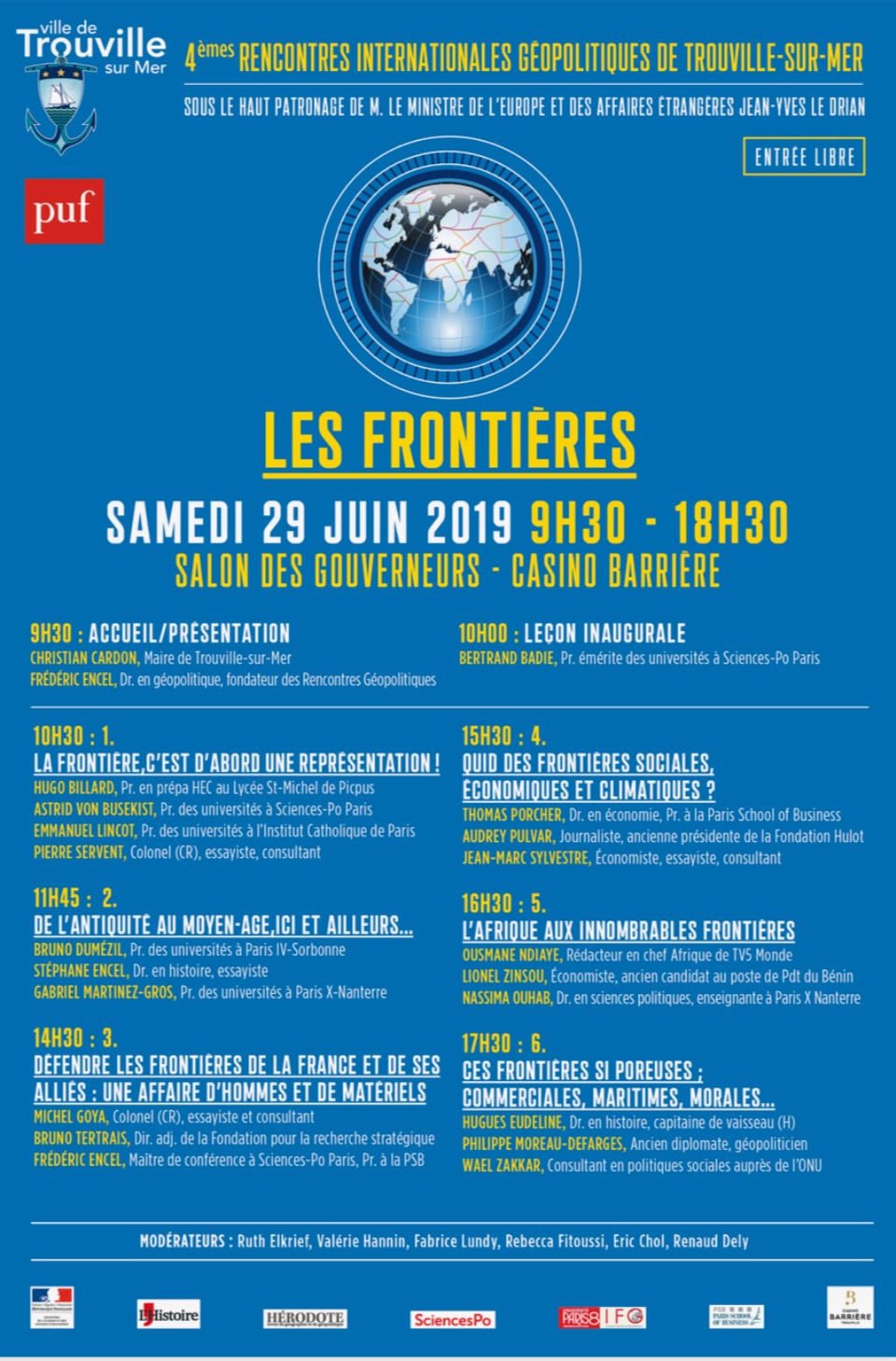Lundi 19 août 2019, une nouvelle et importante attaque des GAT (Groupes armés terroristes) menée dans le nord du Burkina Faso, a fait des dizaines de morts, de blessés et de disparus dans les rangs de l’armée burkinabé.
Pourquoi, six ans après la chevauchée de Serval, un conflit au départ localisé au seul nord-est du Mali, limité à une fraction touareg et dont la solution passait par la satisfaction de revendications politiques légitimes, s’est-il transformé en un embrasement régional paraissant échapper à tout contrôle ?
La réponse tient en deux points :
1) En 2013, pour obtenir une victoire totale, il eut fallu conditionner la progression de Serval et la reconquête des villes du nord du Mali à des concessions politiques du pouvoir de Bamako. Les décideurs français ne l’ont pas voulu.
2) Ceux qui ont défini la stratégie française dans la BSS (Bande sahélo saharienne) ont choisi les nuées contre le réel, à savoir l’illusion de la démocratie et le mirage du développement.
Or, en Afrique, comme démocratie = ethno-mathématique, les ethnies les plus nombreuses remportent automatiquement les élections. Conséquence, au lieu d’éteindre les foyers primaires des incendies, les scrutins les ravivent ou les maintiennent en activité.
Quant au développement, tout a déjà été tenté en la matière depuis les indépendances. En vain. D’ailleurs, comment les politiques, les médias et les « experts », peuvent-ils encore oser parler de développement, alors qu’ils savent que la suicidaire démographie africaine en vitrifie par avance toute éventualité ?
Dans l’état actuel de la situation sécuritaire dans la BSS, le retour au réel est plus que jamais une urgence afin d’identifier les causes profondes de la conflictualité à laquelle nos Forces sont confrontées. Elles ont en effet un besoin vital de cette lisibilité que seule la connaissance du passé permet d’obtenir.L’histoire régionale nous apprend ainsi que les actuels conflits ne sont pas une nouveauté. Résurgences de ceux d’hier, ils s’inscrivent dans une longue chaîne d’évènements expliquant les antagonismes ou les solidarités d’aujourd’hui.
Quelques exemples :
1) A l’ouest du lac Tchad, à partir du Xe siècle et durant plus d’un demi-millénaire, se succédèrent royaumes et empires (Ghana, Mali et Songhay). Tous contrôlaient les voies méridionales d’un commerce transsaharien articulé et même ancré sur des villes-marchés mettant en contact le monde soudanien et le monde méditerranéen. Quand ils étaient forts, ils se faisaient respecter par les éleveurs nomades, leur interdisant de razzier les agriculteurs sédentaires.
2) Après la destruction de l’empire Songhay par le Maroc en 1591, à l’exception des Bambara au nord et des Mossi au sud, les peuples sédentaires de la région ne constituèrent plus de véritables États. Tant chez les Songhay que chez les Djerma, la vie en société ne fut plus dès-lors organisée qu’autour de villages ou de regroupements de villages incapables de se défendre contre la razzia nomade.
3) A la fin du XVIIIe siècle et durant le XIXe, les populations sédentaires de l’ouest du Sahel subirent l’expansion des nomades Peul, mouvement dévastateur qui se fit avec l’alibi de la religion. Trois jihad peul ou apparentés bouleversèrent alors la marqueterie ethno-politique régionale. Celui d’Ousmane (Othman) dan Fodio se fit en pays Haoussa, celui de Seku Ahmadou au Macina et celui d’El-Hadj Omar en pays bambara. Du haut Sénégal à la région tchado-nigeriane, ce ne fut alors que désolation, pillage, massacre et mise en esclavage.
4) Aujourd’hui, dans tout l’ouest africain, ces terribles épisodes sont encore très présents dans les esprits. Leur souvenir constitue le non-dit, et souvent même le véritable soubassement des actuels affrontements ethniques baptisés « communautaires » par idéologie, « pruderie » ou « prudence »… Or, en ne nommant pas les choses, l’on en perd le sens.
En effet, pour les Peul et pour ceux qui se réclament de la « peulitude », Ousmane (Othman) dan Fodio, Seku Ahmadou et El Hadj Omar sont des héros. Les Bambara, Dogon, Mossi, Djerma, Songhay et autres, les voient tout au contraire comme des conquérants esclavagistes cruels et sanguinaires dont l’impérialisme pillard était camouflé derrière un pseudo-justificatif religieux.
Voilà défini l’arrière-plan des actuels conflits du Macina et du Liptako amplifiés par la surpopulation et la péjoration climatique. Refuser de le voir ou considérer cela comme « anecdotique » va, tôt ou tard, conduire à de nouvelles « désillusions » et, hélas, à de nouvelles pertes cruelles.
5) Avant la colonisation, accrochés à la terre qu’ils cultivaient, les sédentaires du fleuve et de ses régions exondées étaient pris dans la tenaille prédatrice des Touareg au nord et des Peul au sud. Pour survivre, ils constituèrent alors de complexes réseaux d’alliances ou de solidarités. Ayant traversé le temps, ils permettent d’expliquer pourquoi certaines « communautés » se rangent aujourd’hui du côté des GAT, quand d’autres les combattent.
Ainsi, comme les raids des Touareg s’exerçaient depuis le désert au nord du fleuve Niger et ceux des Peul à partir des trois émirats du Dallol, du Liptako et du Gwando, afin d’être épargnés, les sédentaires devinrent les tributaires des premiers ou des seconds :
– À l’ouest, les Songhay choisirent d’être ceux des Touareg, lesquels, en échange, protégeaient leurs villages des attaques des Peul. Entre Gao et Ménaka, au fil du temps, certains des tributaires songhay s’assimilèrent quasiment à leurs protecteurs Touareg. Les Imghad le firent ainsi aux Touareg Ifora et les Daoussak aux Touareg Ouelleminden Kel Ataram. Comme la rive nord leur était tributaire, c’était donc sur la rive sud du Niger que les Touareg menaient leurs razzia, avec pour alliés les piroguiers-pêcheurs Kourtey (Kourteis) vivant entre Ayorou et Say.
– Plus à l’est, toujours sur la rive nord du fleuve Niger, les Djerma étaient dans la même situation que leurs voisins songhay mais, en fonction de la localisation géographique des prédateurs nomades, ils choisirent deux systèmes différents de protection. C’est ainsi que les Djerma du sud devinrent tributaires des Peul pour être protégés des Touareg, alors que ceux du nord demandèrent à ces derniers de les défendre contre les Peul.
6) A la fin du XIXe siècle, l’armée française bloqua l’expansion des entités prédatrices nomades dont l’écroulement se fit dans l’allégresse des sédentaires qu’elles exploitaient, dont elles massacraient les hommes et vendaient les femmes et les enfants aux esclavagistes du monde arabo-musulman.
7) La colonisation fut donc en quelque sorte la revanche offerte par la France aux vaincus de la longue histoire africaine. Cependant, dans tout le Sahel occidental, elle eut deux conséquences contradictoires :
– Elle libéra les sédentaires de la prédation nomade, mais, en même temps, elle rassembla razzieurs et razziés dans les limites administratives de l’AOF (Afrique occidentale française).
– Or, avec les indépendances, les délimitations administratives internes à ce vaste ensemble devinrent des frontières d’États à l’intérieur desquelles, comme ils étaient les plus nombreux, les sédentaires l’emportèrent politiquement sur les nomades, selon les lois immuables de l’ethno-mathématique électorale.
Voilà identifié le terreau des conflits allumés depuis une ou deux décennies par des trafiquants de toutes sortes et des islamo-jihadistes immiscés avec opportunisme dans le jeu ethno-politique local et régional. L’ignorer ou le minorer conduit à la superficialité des analyses, à l’inadaptation des décisions et en définitive, à l’impasse actuelle.
Avec des moyens dérisoires à l’échelle du théâtre d’opérations, Barkhane, qui n’est que de passage, n’est évidemment pas en mesure de refermer des plaies ethno-raciales ouvertes depuis la nuit des temps.
Une bonne connaissance du milieu et des hommes pourrait cependant lui permettre d’éviter leur surinfection. Ces points sont développés et illustrés de nombreuses cartes dans mon livre Les Guerres du Sahel des origines à nos jours et dans mon cours vidéo intitulé « Comprendre le conflit au Sahel »
Bernard Lugan

![Association régionale Poitou-Charentes des auditeurs de l'IHEDN [AR-18]](https://ihednpoitoucharentes.fr/wp-content/uploads/2024/10/cropped-Bandeau_AR-18_Site_OVH_v4a-1.jpg)