Il y a 111ans. En casoar et gants blancs
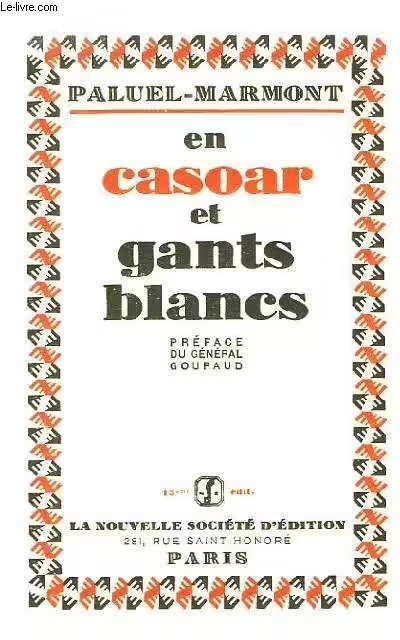
Dans la touffeur de ce début juillet en Gâtine profonde de Parthenay, fouillant dans notre vieille maison de famille un amoncellement de cartons remplis de livres, souvent antédiluviens, je suis tombé en arrêt sur un exemplaire, un peu défraîchi, de « En casoar et gants blancs » de Paluel-Marmont.
Je reconnais cet ouvrage. Il m’a été donné par ma mère lorsque j’avais environ dix ans. Ma maman, fille, sœur, épouse, belle-sœur, et future mère et grand-mère de Saint-Cyrien savait ce qu’elle faisait. Membre de la glorieuse promotion Serment de quatorze, (1963-65) je relis avec soin et plaisir cette œuvre.
De retour à La Rochelle avec ma proie, en rangeant cette fois ma volumineuse paperasserie, je tombe sur le programme de notre gala parisien et le fascicule de notre baptême. Tous les deux reprennent, quasiment in-extenso le premier chapitre de ce livre « Le baptême au crépuscule ».
Je ne vous fais pas l’injure de vous retracer cet évènement et le serment de « monter à l’assaut en casoar et gants blancs » qui le suivit, ce 31 juillet août.
Il est certain que relativement peu de Cyrards de la « Montmirail » et encore moins de la « Croix du drapeau » y participèrent, emportés pat l’enthousiasme d’Allard-Méeus, le « barde de la Montmirail » et de Fayolle.
D’ailleurs, en dehors de Paluel-Marmont, je n’ai trouvé que peu de traces de ce serment. Curieusement, le général Desmazes, vorace à la « Croix du drapeau », n’en fait pas état dans son histoire de Saint-Cyr éditée en 1948 (cadeau que me fit la promo de mon père, la Maroc et Syrie).
Le général Carpentier, élève de la « Croix du Drapeau » y fait allusion dans ses mémoires sans dire s’il l’a prêté.
Pour commentaires, tout ce que j’ai réussi à retrouver c’est un fielleux propos récent sur Internet qualifiant de « bravache » ce serment exalté. Fermez le ban…
N’oublions pas qu’à cette époque, nous sommes dans la France du « Panache ». Cyrano et Chantecler sont des références populaires.
Je ne philosopherai pas sur ce serment qui a réellement existé.
Il marque l’engagement, le sacrifice volontaire, le don de soi pour une cause supérieure, de jeunes gens enthousiastes, pénétrés de l’amour de la patrie. Ma réflexion est autre.
Quelle a pu être l’éducation militaire de ces jeunes hommes qui a amené à une telle hécatombe dans les premiers mois de la guerre ?
Et j’en viens à la doctrine officielle de l’armée française en août 14, « l’offensive à outrance ». Ce n’est pas la doctrine de Joffre, le généralissime, organisateur plus que stratège. Il applique les idées d’autres idéologues. C’est plutôt celle des « Jeunes turcs » qui l’entourent dans son état-major, Gamelin en tête. C’est surtout la doctrine déclinée par Foch à la tête de l’Ecole de Guerre, dans les années précédentes.
Cette idéologie fut conçue pour le niveau stratégique national, en réaction à la doctrine des « bonnes positions » qui nous amena inéluctablement à la défaite à Sedan, en septembre 1870, et en mépris de la ligne de fortifications Séré de Rivière, construite en réaction à la défaite dans les années 1880.
Cette doctrine fut dénaturée en descendant l’échelle hiérarchique.
Appliquée à la compagnie, elle fut à l’origine des journées sanglantes d’août 14 dont le sommet est le 22 août qui vit la mort de quarante-mille combattants, soit vingt-sept mille Français et treize-mille Allemands.
La mitrailleuse allemande bien postée l’emporta toujours sur la baïonnette française, à bout de souffle après des centaines de mètres de course sous la capote bleue et le pantalon rouge, couleurs des Gardes Françaises en 1789 !
L’auteur de cette théorie est connu. Il s’agit du chef de bataillon de Grandmaison qui écrivit en 1908 « Dressage de l’infanterie en vue du combat », puis prononça comme colonel aux officiers du CHEM en 1911 deux conférences sur le même thème. Il mourût au combat à Soissons en 1915.
Comme Ardant du Picq une cinquantaine d’années plus tôt, voire comme le général Russe Souvorov à la fin du XVIIIème, il met en avant les forces morales. Jusqu’ici, rien de neuf.
Mais dans le feu de l’action, il dénie tout pouvoir préalable au tir et fait confiance à l’exaltation morale du soldat. Ainsi écrit-il dans son premier ouvrage que « Le seul mode d’action de l’infanterie est le mouvement en avant par le feu ».
Donc, le feu n’est qu’un moyen pour permettre le mouvement en avant, principe absolu du combat. « Vaincre, c’est avancer » écrit-il encore.
Et l’on avance parce que le soldat a le moral !
Il écrit aussi « Le feu du défenseur ne détruit pas l’assaillant, mais il le démoralise d’une façon assez profonde pour supprimer chez lui toute capacité d’effort ». Les combattants de la Marne apprécieront.
C’est simplissime. Cela facilite l’instruction des unités.
Grandmaison ignore totalement la formule de Pétain, son grand ancien, « Le feu tue ». Il n’a pas entendu Lanrezac s’exclamer « Attaquons, attaquons… comme la lune ». Il ignore totalement l’existence, donc l’emploi, de la mitrailleuse, pourtant née une quarantaine d’années plus tôt. Il ne connaît que Souvorof, relayé par le général Dragomirof, à la fin du XIXème « La balle manque son but, la baïonnette ne manque pas le sien ; la balle est une folle, la baïonnette est une luronne ».
Et pour les cadres de contact, c’est tellement plus facile d’apprendre à une compagnie, une section, une escouade à courir éperdument baïonnette en avant que de la former à la combinaison des feux et du mouvement, définition de la manœuvre.
En plus, l’auteur écrivît en conclusion « Il s’ensuit que l’officier français au combat doit être plus un donneur d’exemple qu’un donneur d’ordres ».
La mort héroïque d’Allard-Méeus, celle de Fayolle, premiers récits de l’ouvrage après celui du baptême, illustrent parfaitement, hélas, ces propos irraisonnés.
Général Philippe MOUNIER [Fantassin].
![Association régionale Poitou-Charentes des auditeurs de l'IHEDN [AR-18]](https://ihednpoitoucharentes.fr/wp-content/uploads/2024/10/cropped-Bandeau_AR-18_Site_OVH_v4a-1.jpg)
Bonjour et merci pour cette lecture édifiante.
On y penserait presque avec les offensives de fantassins en cours dans le Donbass pour percer le front…
Guy Brangier
Génial ! Merci. Amicalement
Général Marc Théry